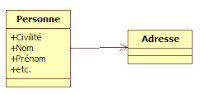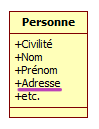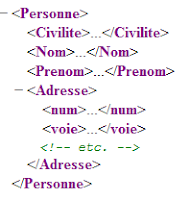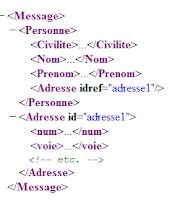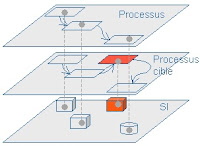Vos décisions d'urbaniste ne sont pas écoutées, prises en compte, ou restent sans effet ?
La gouvernance d'un SI est un jeu subtil.
Créez un système ou une application, et les vautours s'en empareront.
Tentez une fusion entre deux systèmes, et les vautours vous en empêcheront.
Puissance et gloire à qui est responsable d'une application, d'un système, d'un batch, ou même d'une simple table : il pilote un budget, des ressources, des besoins exprimés, des roadmaps proposées. Opacité et chiffrages exagérés faisant bon ménage, la machine s'emballe, et la maintenance évolutive ou fonctionnelle du système, qu'on essaye de placer comme maillon essentiel de tout projet de l'entreprise, devient une activité très rentable (pour le CV du chefaillon) : participation à des gros projet, pilotage d'un budget immense, d'une équipe qui se compte en dizaines de personnes. En bref, l'eldorado du middle management.
Et comme notre chefaillon n'est pas seul de son espèce, l'éco-système de type jungle profonde (avec les lianes et les piranhas) se propage dans l'entreprise.
Ces chefaillons ont-ils des chefs ? Souvent, oui. Et si le niveau du dessus n'est pas plus intègre (je n'ose dire honnête), il verra vite son intérêt à diriger ces sommes de budgets et d'équipes (super-puissance, super-gloire). Vous vous retrouvez face à une fédération de petites baronnies, ingouvernables, où toute décision ressort plus de la diplomatie que du respect du client (voire de la sauvegarde de l'entreprise)...
Vous savez, le client de l'entreprise, celui qui donne - pour de vrai - de l'argent, et qui aimerait entendre autre chose que "c'est pas nous, c'est une panne informatique". C'est justement au nom du client qu'il faudra proposer des actions de remise en ordre du système.
Mettez un urbaniste (ou une quelconque personne de bonne foi) au milieu de ce panier de crabes, il ne fera pas long feu. Il sera soit évincé de toute décision, soit manipulé par l'un ou l'autre de ces petits chefs cherchant à mettre la main sur un nouveau système.
A ce niveau, pour sauver l'entreprise et les promesses faites au client, quelques actions s'imposent :
- impliquer l'actionnaire, lui montrer l'impact de ce fonctionnement sur le client ;
- objectiver le DSI sur les coûts (DSI = cost killer) ;
- missionner quelques consultants externes pour révéler l'impact négatif des baronnies sur l'activité commerciale de la société (audit par une autre branche de l'entreprise, par une autre filiale du groupe, par un cabinet indépendant, etc.) ;
- lancer une politique de restriction du nombre d'applications ou systèmes qui participent au SI ;
- renforcer les équipes transverses du SI (contrôle de gestion SI, cellule d'urbanistes, gestionnaires de projet ou PMO, pôle d'exploitation SI, etc.), surtout face à la prolifération de petites équipes gérant 1 à 2 applications chacune ;
- interdire (en COPIL, COPROJ, CODIR, CO-ARCH, CO-URBA, ...) l'emploi de termes du type "trop compliqué pour toi", "on ne sait pas comment c'est développé", "on a toujours fait comme ça", etc. ;
- reformuler les objectifs de tout responsable d'équipe, notamment (a) contribution à la création de bénéfice et non de chiffre d'affaire, (b) objectifs quantifiés d'outsourcing, (c) objectifs quantifiés d'urbanisation (flux normalisés, processus modélisés et mis en oeuvre, etc.).
Pour finir, quelques phrases qui doivent vous mettre la puce à l'oreille :
"Pour écrire cette fiche d'évolution ? Il me faut 5 jours minimum."
"Cette action débutera le 15 décembre, sur le budget de l'année en cours."
"On ne TOUCHE PAS à mon périmètre !"
"Ça ? c'est très compliqué, seule mon équipe est compétente."
"Je ne pense pas qu'un urbaniste puisse me dire ce que je dois faire."